Analyse des échanges réparateurs sur le SALON 40 ANS et PLUS :
L'on dénombre 48 énoncés offensants pour 30 situations d’embarras recensées. Dix d’entre elles comptent au moins deux offenses.
Ces dernières sont proportionnellement deux fois moins nombreuses sur la forme de l’intervention, que sur le fond. 2/3 des F.T.A. portent sur une atteinte à la face positive (reproches, injures, insultes), 1/3 sur la face négative (ordre, empiètement sur les réserves d’informations…). Les offenses de forme proviennent essentiellement de troubles de l’engagement (absence de réponse) et de ratés.
La moitié des énoncés offensants font l’objet d’une complainte (24 sur 48). La demande de réparation est exprimée implicitement dans 23 cas contre 1 explicite. L’exception porte sur un raté et la correction effectuée par l’offensé.
L’on notera une forte proportion de réaction négatives à la complainte (17 sur 24). Pour autant, près de la moitié des énoncés offensants aboutissent à des excuses (21 sur 48). Il faut y voir une capacité apparemment plus grande des membres, sur les salons + de 40 ans, à reconnaître spontanément leur faute : 12 interventions liées à des réparations, sur 21 au total, sont émises sans le préalable de la complainte. Par ailleurs, la moitié des réalisations implicites de l’excuse (les justifications) sont basées sur une reconnaissance de la faute. On note également un exemple de réparation symbolique par l’utilisation d’un smiley.
Enfin, il faut souligner les réactions à l’excuse : 10 positives contre 2 (mais ces deux là cumulent contestation de la justification, ironie, confirmation de l’offense, expression de colère et mise en cause de la sincérité de l’offenseur.) La réalisation implicite est la plus fréquente et porte sur une minimisation des dommages infligés.
L’on soulignera, avant de conclure sur le tableau général et les commentaires comparés des différents salons, une seule phase de remerciements de l’offenseur : comme nous l’avons mentionné précédemment, nous n’avons pas inclu cette composante dans notre grille d’analyse, bien qu’elle soit clairement spécifiée par Goffman, en raison de son caractère manifestement très exceptionnel.
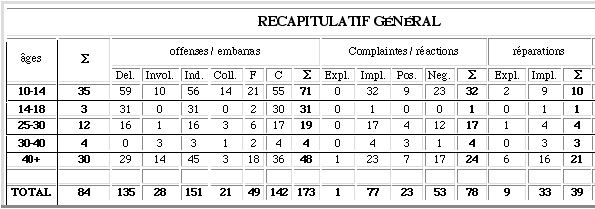
- Conclusion sur les échanges réparateurs :
Nous commencerons par rappeler que les sommes de résultats ici compilées, bien que juste (exacte dans la limite d’un biais que nous avons évoqué précédemment) ne doivent pas nous conduire à de trop hâtives conclusions. L’application systématique de la grille d’analyse du face-à-face à chacun des mouvements des 84 situations d’embarras, riche d’enseignement qualitatif aurait certainement gagnée à être commentée plus largement. Nous ne saurions que trop inciter le lecteur à consulter les annexes et les fiches d’analyses individuelles pour se référer aux éléments contextuels et juger par ailleurs de la difficulté inhérente à la classification (disponible en version papier uniquement).
Nous retiendrons tout de même de cette synthèse quantitative à visée comparatiste quelques caractéristiques qui semblent se dessiner :
L’on constatera que pour une durée quasi-équivalente d’observation sur les salons 10-14 ans et plus de 40 ans (environ 10 heures chacun) on recense un nombre de situations réparatrices relativement similaire (35 pour les salons 10-14 ans, 30 pour les salons plus de 40 ans). Reste qu’à l’intérieur de ces mêmes situations, se cachent de fortes variations : 71 énoncés offensants chez les 10-14 ans contre 48 chez les plus de 40 ans. Proportionnellement, l’on constate une plus forte domination des offenses de contenu chez les plus jeunes, même s’il faut souligner plus de « cumul » dans les atteintes forme-contenu, sur les salons plus de 40 ans.
Il est entendu, en vertu du principe de l’environnement anonyme que l’on ne peut interpréter ces comportements comme révélateurs de pratiques propres à une « génération » d’individus. Les salons 10-14 ans ne sont probablement pas fréquentés exclusivement par des participants de moins de 15 ans, de même pour tous les autres salons. Mais l’on présume (avec à l’appui quelques rares et fragiles indices, potentiellement fallacieux, tels que l’asv, le profil, le vocabulaire, l’orthographe, la syntaxe…) que les participants tendent à se rassembler par « clan ». D’ailleurs il faut souligner le cas particulier de ce que nous avons dénommé « offenses générationnelles », et qui correspond à un nombre significatif d’énoncés offensants mettant directement en cause la différence d’âge. Nous ne résistons pas à la tentation d’en fournir quelques exemples :
09/02/01 salon 10-14#109
(fiche n°1)
taz_99991>
iseut4> TAGUEL LA VIELLE
06/04/01 40+#420
(Fiche n°59)
Comme le signale Bourdieu : « on doit se garder d’oublier que les rapports de communication par excellence que sont les échanges linguistiques sont aussi des rapports de pouvoir où s’actualisent les rapports de force entre les locuteurs ou leur groupe respectif » (1993 : 14).
Outre ces énoncés insultants, l’on rencontre plus fréquemment quelques « piques » portée à la face positive des participants, par exemple :
m.lagosanto>
SALUT
m.lagosanto>
ALORS LES VIEUX CA VA
14/04/01 22h01
salon 30 - 40 ans#550
adpepper>
anne-lise.lisou> kel agressivité
cette petite!!
(…)
naisana_lilas>
anne-lise.lisou>
tu pourrai t'adresser directement a moi si tu as quelquechose a dire et
ce n'est pas parce que j'ai 23 ans que je suis une "petite"
19/03/01 15h18
25 - 30 ans#113
Cette observation peut être rapprochée de ce que Lipiansky désigne par le terme de « clivage ». La scission du groupe intervient parfois, nous dit-il, sur des questions d’âge :
« La fonction de l’antagonisme est chaque fois de rejeter les défauts, les difficultés, les responsabilités sur l’ « autre partie » et de se donner ainsi une identité positive, partagée avec ceux du « bon sous-groupe ». (Lipiansky, 1992 : 82).
Complaintes et réparations s’expriment essentiellement de manière implicite. Le nombre de réparations total étant exactement égal à la moitié du nombre des complaintes. L’on notera enfin pour conclure une apparente corrélation entre les thématiques des salons, l’avancement de l’âge, et le nombre de réaction à l’excuse : 5 réactions (dont 3 négatives) chez les 10-14 ans ; 12 (dont 10 positives) chez les plus de 40 ans. Le nombre de réactions positives chez les plus de 40 ans s’explique en partie par le fait que les excuses succèdent généralement à des offenses de forme plus que de contenu (qui elles sont, dans le cas des injures, particulièrement impardonnables).
Après les excuses qui sont « la réalisation par excellence de la politesse négative », nous allons évoquer les « anti-FTA » que constituent les compliments. « Tout comme l’analyse des excuses permet de faire l’inventaire de ce qui est, dans une société donnée, considéré comme une offense, celle des compliments permet de dégager les objets de valeurs caractéristiques d’une communauté » (Kerbrat-Orecchioni, 1998b : 219)
La structure générale de l’échange complimenteur se présente comme « une chaîne d’actions constituée principalement d’une intervention initiative : le compliment, produit par le complimenteur (L1) à l’intention du complimenté (L2) et d’une intervention réactive : la réponse au compliment, produite par L2 à l’intention de L1 » (Kerbrat-Oreccchioni, 1998b : 201).
Kerbrat-Orecchioni souligne que les formules performatives telles que « (je te fais) tous mes compliments » sont très minoritaires parmi l’ensemble des énoncés perçus comme des compliments. « On peut ainsi considérer comme tel, toute assertion évaluative positive portant sur une qualité ou une propriété de l’allocutaire A (un compliment c’est une louange adressée à la personne « concernée ») ou bien encore sur une qualité ou une propriété d’une personne plus ou moins étroitement liée à A » (1998b : 202)
En raison de la distance et de l’immatérialité de l’échange cyberconversationnel, deux catégories importantes (peut–être même les plus fréquentes) de compliments se réduisent : ceux portant sur l’apparence physique et sur les possessions matérielles (il faut distinguer dans ce dernier cas les compliments portés sur l’objet matériel de ceux félicitant un choix ou un élan porté vers celui-ci.) Mais on note toutefois la possibilité d’un usage combiné du dialogue en direct et de la boîte aux lettres électronique (Email) par l’envoi, parallèle à la conversation, de photos par exemple.
Les qualités personnelles autres que physiques peuvent être louées, mais en sachant que l’« on complimente en théorie des connaissances » ; or, la question de l’interconnaissance sur le chat est complexe puisqu’elle ne porte que sur la reconnaissance mutuelle des pseudos, et que par ailleurs, l’interconnaissance ne fonde pas, n’est pas corollaire du contact. A priori, on peut penser que les qualités personnelles pouvant être louées sont en rapport avec la vivacité d’esprit, l’intelligence, la gentillesse, l’humour ou la répartie… Remarquons tout de même que la vivacité est globalement une nécessité, proche d’une norme cyberconversationnelle.
Une seconde catégorie de compliments exprimés en face-à-face pourrait être observée, en lien avec la maîtrise technique de l’informatique : la valorisation des compétences et réalisations.
En ce qui concerne la nature de la relation interpersonnelle qui peut exister entre complimenteur et complimenté, on reprendra les conclusions de Kerbrat-Orecchioni (idem: 215) : « Les compliments manifestent une évidente prédilection pour la relation familière, en relation distante ils seront comme il se doit plus formels » (…) La relation de type égalitaire est particulièrement propice à la production et à l’échange de compliments ».
Malgré la nature favorable des relations entre les membres de la communauté caramail (relation familière d’idéal égalitaire) l’on verra que peu de compliments ont été recensés dans notre corpus : il faut y voir sans doute le poids du cadre virtuel des échanges, mais également la substitution de ce recours au compliment par l’utilisation fréquente et précédemment évoquée des hypocoristiques tel que nous le montre l’exemple ci-dessous :
15/03/01
salon 40 ans et+#48
Il est vrai que les termes de tendresse comme les compliments visent la même fonction essentielle selon Kerbrat-Orecchioni, « de renforcer la solidarité existante entre les interlocuteurs » (ibid.: 213)
Distinguons, avant de les collecter, les compliments directs, des compliments indirects : selon la terminologie de Kerbrat-Orecchioni, c’est la nature de la cible visée qui les différencie (certains évaluent positivement l’allocutaire, d’autres, une personne différente de lui et l’atteignent donc par ricochet). Nous préférerons à cette conception, celle de Manes & Wolfson (ibid.: 204-205) plus pragmatique à nos yeux dans le cadre du chat, et qui correspond à notre définition antérieure : seront qualifiés de directs, les compliments qui s’adresse directement à la cible.
Les compliments explicites des compliments implicites : « un compliment est explicite dès lors qu’il s’exprime par une formule performative ou plus communément, par une assertion dans laquelle le jugement évaluatif est posé (comme tu es belle). Il est implicite lorsque ce jugement est présupposé (Salut Beauté !) ou sous entendu (il en a de la chance votre mari). » (ibid. ).
Nous avons recueilli seulement 5 énoncés complimenteurs (pour un total de 5 séquences) répondant aux caractéristiques évoquées infra. Précisons que nous avons écarté les exclamations approbatives qui ne constituent pas une assertion positive porté directement sur quelqu’un, même si la réaction à ces énoncés (le remerciement) montre que l’éloge est bien perçu :
the.criminals> maxmaster> bravo
(…)
fiona.vincent>
maxmaster> super
maxmaster>
fiona.vincent> merci
21/03/01
salon 10-14 ans #113
De même que plusieurs autres énoncés dont la valeur appréciative est significative mais qui ne portent pas sur l’individu : deux exemples dans des contextes différents. Le premier est lié à la réalisation de dessins ASCII (cf. infra.) par un participant, l’autre souligne la vivacité d’esprit d’une locutrice mais élide le pronom personnel référant au complimenté. Comme dans les illustrations précédentes ce qui est loué c’est la réalisation de l’individu plus que lui même.
maxmaster> ¤
maxmaster>
¤ h i , m y h o n e y .
maxmaster>
¤ i ' m r e a l l y h a p p y t
h a t
maxmaster>
¤ m y m a i l b o x i s f u l l
o f t h o s e
maxmaster>
¤ p r e t t y h e a r t s e v e
r y d a y . s o ,
maxmaster>
¤ i j u s t t h o u g h t i w o
u l d r e t u r n
maxmaster>
¤ t h e f a v o r , j u s t i n
c a s e y o u ' d
maxmaster>
¤ n o t y e t r e a l i z e d j
u s t h o w i
maxmaster>
¤ l o v e y o u . y o u a r e j
u s t
maxmaster>
¤ s o v e r y , v e r y , v e r
y
maxmaster>
¤ e x t r a o r d i n a r i l y
maxmaster>
¤ s p e c i a l a n d
maxmaster>
¤ i a d o r e
maxmaster>
¤ y o u
maxmaster>
¤ !
maxmaster>
¤
(…)
sniper.killer.2>
maxmaster> C'est
bien
la_danse_du_youkoulele> maxmaster> c joli
(…)
le_pseudo_ki_fait_parler>
maxmaster> tres
beau comment tu fai?????
maxmaster> le_pseudo_ki_fait_parler> ben j'ais telecharger le sky graph
(…)
f-d-bite> il est bien homer
21/03/01
salon 10-14 ans #113
corinne589>
love.story2> ouais elle se prenais
plus haut que ses fesses
(…)
laura__olive>
je suis vulgaire et
je vous nique tous
(…)
love.story2>
corinne589> mais
maintenant plus basse que ses talons
corinne589> love.story2> bien dit
14/03/01
salon
10-14#48
· L’intervention réactive : la réaction au compliment :
On distingue les réactions positives qui prennent la forme :
- d’un accord, même si ce type de réponse bien qu’attesté est rare
- d’une limitation de la portée de l’évaluation (restriction, réserve, accentuation sur un défaut…)
- d’un commentaire, qui « étoffe l’expression de l’accord et du même coup l’estompe » (idem.: 235)
Les réponses négatives :
- le désaccord (plus ou moins nuancé)
- la dénégation
Les 5 séquences d’échanges complimenteurs sont compilées avec les mêmes conventions que celles appliquées pour les échanges réparateurs (suppression de plus d’un énoncé secondaire représenté par (…), les compliments sont soulignés, les réactions également quand elles ont été formulées. Certains énoncés contextuels ont parfois été conservés pour une meilleure compréhension des séquences.)
1) 15/03/01 14-18 #140
![]()
2) 21/03/01 10-14#113
the.criminals> maxmaster> t trop fort
![]()
3) 09/04/01 40+#468
hollywood.41>
bigkic> tu as de l'humour toi
!
(…)
bigkic> hollywood.41>
merci
![]()
4) 09/04/01 40+#468
larauffe>
bon desolée je pars
larauffe>
bye
larauffe>
merci d'avoir cru a mes conneries
(…)
larauffe>
jean.besaloeil> t'es cool toi
jean.besaloeil> larauffe> oui, tu sais je ne prends que ce que je veux
![]()
5) 16/04/01 40+#562
feline.feline1>
les filles pour ceux qui connaissnet pas lady elle est amie #05 tres
sympa
a.laddy>
feline.feline1> merci à toi
feline.feline1>
a.laddy> de rien ma belle
L’on note 4 compliments directement adressés aux complimentés contre un seul indirect. Il s’agit de la présentation flatteuse d’un membre par une autre à l’ensemble du groupe (n°5). On observera que cet échange complimenteur intervient typiquement au cours de la séquence d’ouverture, ce qui constitue pour Kerbrat-Orecchioni « une composante facultative mais très fréquemment attestée » (1998b : 217). Il faut noter quant à la place de ce type d’énonciation, qu’en tant que rituel performatif, le compliment se rencontre également bien que plus rarement, dans les séquences de clôture où il est « mis au service de la négociation de la relation » (ibid.).
L’exemple n°4 est significatif.
L’on considère qu’un seul énoncé est implicite (n°1) alors que les 4 autres félicitent explicitement le bénéficiaire du compliment, pour son sens de l’humour, son caractère « cool », ou « sympa ».
En matière de réaction au compliment, on note 3 réactions positives, une expression de désaccord, et une absence de réaction.
Parmi les réactions positives, on remarque deux remerciements (ce qui proportionnellement est important alors que Kerbrat-Orecchioni considère cette composante comme rare (1998b : 239). Enfin, autre réponse positive, un commentaire, qui assume un rôle de justification (n° 4) : cette réaction est permise par le fait que l’acte de langage s’intègre dans un cadre plus large : « la réaction au compliment ne s’impose que si celui-ci constitue à lui seul l’intervention, ou si étant accompagné d’autres actes il y fait figure d’acte directeur » (Idem.: 201)
L’on conclura cette partie consacrée aux échanges complimenteurs est signalant une certaine stéréotypie dans la formulation des compliments. Une tendance qui, à en croire Kerbrat-Orecchioni, est un phénomène général (ibid.: 213).
Retour table des matières